Le roman de Pierre Rivière
de Viviane Janouin-Benanti
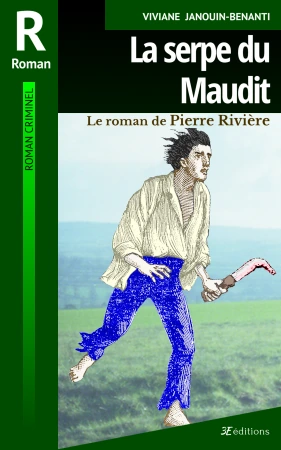
La serpe du Maudit – Le roman de Pierre Rivière de Viviane Janouin-Benanti est de ces livres rares qui donnent l’impression de lire un grand fait divers… tout en traversant un pan entier de l’Histoire. Roman « inspiré de faits réels » et solidement documenté, il reconstitue l’itinéraire d’un jeune paysan normand du XIXᵉ siècle, Pierre Rivière, auteur d’un triple meurtre familial qui fera basculer une région – et surtout interrogera durablement la justice, la médecine et l’idée même de responsabilité.
Un roman noir… mais aussi un roman d’époque
Dès les premières pages, Viviane Janouin-Benanti installe le décor : la Normandie rurale, les fermes, les chemins, le poids du travail, les humiliations sociales, les violences domestiques et la religion comme refuge – ou comme brasier. La narration prend le temps d’ancrer la famille Rivière dans la durée : les origines, les tensions, les rancœurs, les fragilités psychiques. La mère, Marie, apparaît tôt comme un personnage instable, traversé de crises et de larmes « sans explication », rongé par un mal dont personne ne sait le nom. Le père, Basile, se retrouve pris dans une mécanique d’épuisement et de honte sociale, jusqu’à envisager l’irréparable.
Surtout, le livre réussit une chose que peu de romans criminels osent : faire sentir la pression du temps historique. Au fil des chapitres, l’autrice alterne la tragédie intime et le tumulte national : l’après-Empire, l’occupation étrangère, les brutalités et la misère, puis la Restauration et ses fractures politiques. On croise l’ombre des ultras, des sociétés secrètes, des affrontements idéologiques, et même la Charbonnerie – avec une précision vivante, jamais scolaire. Cette toile de fond n’est pas un simple décor : elle nourrit l’atmosphère mentale du récit, cette sensation d’un monde qui se serre, d’une époque qui juge vite, punit fort, classe les gens en « bons » et « maudits ».
Le cœur du livre : la fabrication d’un geste impensable
Au centre, il y a Pierre. Et c’est là que le roman prend toute sa force. Viviane Janouin-Benanti ne se contente pas d’énoncer un crime : elle reconstruit la progression intérieure qui y mène, sans raccourci. Pierre est présenté comme intelligent, lecteur, habité – et bientôt envahi. La folie, ici, n’est pas un masque hollywoodien : elle est un glissement, une logique qui se referme sur elle-même, un système d’idées qui paraît « cohérent » à celui qui le subit, et incompréhensible pour tous les autres.
L’un des passages les plus glaçants du livre, c’est quand Pierre transforme son projet en mission : il se persuade qu’il va délivrer son père, que son acte sera une preuve d’amour absolu, presque un sacrifice. Il pousse même sa logique jusqu’à une décision atroce : tuer aussi le petit Jules, « le préféré », pour que la douleur du père soit telle qu’il ne souffrira plus de voir son fils condamné. On est là au bord d’un abîme : comment une pensée peut-elle se tordre au point de confondre protection et destruction ?
Le crime, commis à la serpe, éclate alors comme une déflagration – et l’autrice, sans voyeurisme, fait sentir l’instant où « là où il y a à peine une demi-heure était la vie, la mort avait surgi ». La scène n’a pas besoin d’en faire trop : c’est la simplicité brute des gestes et la stupeur des témoins qui suffisent à pétrifier.
Après le choc : la cavale, la honte, et le retour de la raison
Mais le roman ne s’arrête pas au meurtre. Il s’attache à l’après, à ce moment vertigineux où l’idée grandiose s’effondre. Pierre marche, fuit, délire, puis revient par à-coups à la lucidité. Il se lave dans une rivière, nettoie l’arme et la jette. Il croise des gens, parle comme s’il n’avait pas encore intégré ce qu’il a fait. Et peu à peu, la grandeur rêvée se change en une seule certitude : il n’est pas un héros, il est « un assassin ».
Le roman rend très bien cette bascule intime : d’un côté, une exaltation mystique (« délivrer », « expier », « être consacré »), de l’autre, la honte nue. On le voit même tenter d’accrocher une corde à un arbre pour se pendre, avant d’être rattrapé par la peur de l’enfer et les leçons du curé. Cette contradiction – vouloir disparaître, mais redouter le châtiment ultime – donne au personnage une épaisseur tragique. On lit alors moins l’histoire d’un monstre que celle d’un être humain pris dans un étau : croyances, culpabilité, délires, et retour brutal du réel.
Le livre insiste aussi sur l’ampleur de la fuite : une « folle cavale » de près de 600 kilomètres en un mois, du 3 juin au 2 juillet 1835. L’autrice en fait une odyssée sombre, où la marche devient à la fois survie, pénitence, et tentative désespérée de se retrouver soi-même.
Le manuscrit : le nœud moral du roman
Un élément donne au récit un relief unique : le manuscrit. Pendant l’instruction, Pierre propose de tout raconter par écrit. Il rédige en quinze jours un texte de quarante-neuf pages, d’une mémoire et d’une précision étonnantes, où il explique sa préparation, son geste, et ses lendemains. Le roman fait de ce document une véritable bombe : car comment concilier une telle lucidité narrative avec l’idée de folie ?
C’est là que Viviane Janouin-Benanti touche au cœur du sujet : au XIXᵉ siècle, « ou l’on était sain d’esprit ou on était fou » – la schizophrénie, les crises, les états mixtes, tout cela n’a pas encore de place évidente dans les catégories mentales des magistrats. Et ce manuscrit, au lieu de sauver Pierre, le condamne presque : il devient la « preuve » que l’accusé comprend, se souvient, analyse… donc serait responsable.
Le procès : justice, presse, opinion publique
Le procès, lui, est un théâtre. Les proches et les voisins témoignent : « l’accusé était fou », chacun apporte ses exemples. La défense, avec Maître Chauveau, s’appuie sur cette folie évidente. Pourtant, l’accusation réclame la peine capitale. Et le jury condamne Pierre Rivière à mort le 12 novembre 1835.
Mais l’affaire ne s’éteint pas : pourvoi rejeté, puis revirement moral de dix jurés qui demandent la grâce ; la presse locale s’en mêle, les lecteurs écrivent, l’opinion débat : faut-il être fou « tout le temps » pour être reconnu fou ? faut-il être un imbécile pour être déclaré dément ?
Ces questions, posées au XIXᵉ siècle, résonnent encore aujourd’hui. Et c’est l’une des grandes réussites du livre : faire d’un drame rural une interrogation moderne, presque contemporaine, sur la frontière entre trouble mental, responsabilité pénale et regard social.
Le roi accorde finalement la grâce le 10 février 1836 : la peine est commuée en réclusion perpétuelle. Là encore, le roman évite le « happy end ». Car l’enfermement fait basculer Pierre : privé de marche, privé d’air, la folie reprend, le mysticisme s’exacerbe. Et l’histoire, cruelle, se termine sur un dernier vertige : en octobre 1840, Pierre se pend à la prison de Beaulieu.
Style, rythme, et puissance d’évocation
Le style de Viviane Janouin-Benanti est direct, visuel, porté par une narration qui privilégie l’efficacité et le concret. Elle sait faire parler une époque sans l’alourdir : les gestes des paysans, le poids des dettes, la rumeur des villages, la violence sourde des humiliations. Elle sait aussi mêler l’intime et le politique : on passe d’un drame familial à l’évocation de la censure, des sociétés secrètes, des affrontements de la Restauration – et cela donne au roman une respiration particulière, comme une alternance entre la petite histoire et la grande.
Un passage emblématique, par exemple, raconte une scène de traque idéologique : on fouille, on traque les livres, on brûle des bibliothèques sur la place, comme si la pensée elle-même était un danger. Ce n’est pas un détail : cela éclaire le climat d’un monde où l’on veut purifier, contrôler, imposer – et où un esprit fragile peut se sentir « désigné », « missionné », ou condamné d’avance.
Le cahier photos, enfin, renforce la sensation de réel : cartes, signalement diffusé, images de Caen, fac-similés liés au manuscrit et au procès. On referme le livre avec cette impression troublante : ce que l’on vient de lire est un roman… mais aussi une empreinte d’archive.
Pourquoi ce livre donne envie d’être lu
Parce qu’il ne se contente pas de raconter un crime : il raconte une collision. Collision entre une famille et une époque. Entre un esprit et un monde qui ne sait pas nommer la maladie. Entre la justice et la compassion. Entre le désir de comprendre et la tentation de maudire.
Et parce que Pierre Rivière, malgré l’horreur, reste un personnage romanesque au sens le plus fort : un être qui pense, qui justifie, qui se perd, qui regrette, qui écrit, et qui finit brisé. Le roman ne cherche pas à « excuser ». Il cherche à faire voir. Et c’est précisément ce qui rend la lecture si prenante.
Plusieurs lecteurs et critiques l’ont dit : c’est « un ouvrage qu’on a du mal à lâcher », et sa force tient aussi à ces allers-retours entre la tragédie individuelle et « l’Histoire avec un grand H ». On en sort secoué – et curieusement plus lucide.
Où acheter le livre ?
Livre broché – 14 euros :
Chez Amazon : La serpe du Maudit (livre broché)
Ebook – 4,99 euros :
À la FNAC : La serpe du Maudit (epub)
Chez Amazon (Kindle) : La serpe du Maudit (Kindle)
À l’Apple Store : La serpe du Maudit (epub)
Chez Kobo : La serpe du Maudit (epub)
Sur Google Play : La serpe du Maudit (epub)
PDF – 4,99 euros :
Chez 3E éditions : La serpe du Maudit (PDF)
